Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants. #
Par Dr Éric Maeker, Bérengère Maeker-Poquet • Publié le • Mis à jour le
Articles mis en avant #

ESSENTIEL
🚀 Empathie dans les soins
500 vues
🩺 Professionnel
👨👩👧 Famille
💼 Aidant
🔥 Mise à jour
IA plus empathique que médecins ? Le système transforme soignants en robots
👉 L'IA bat les soignants sur l'empathie dans 87% des études. Le vrai problème ? Un système de santé qui empêche les humains d'être humains. Analyse et solutions.
10 minutes
•
Débutant
•
Perspective
99% trouvent cet article utile
Publié le 23 novembre 2025
Mis à jour le 9 décembre 2025

ESSENTIEL
🚀 Empathie dans les soins
900 vues
🩺 Professionnel
👨👩👧 Famille
💼 Aidant
🔥 Mise à jour
Empathie dans les soins : dossier complet 17 experts gériatrie 2025
👉 Dossier référence sur l'empathie thérapeutique en gériatrie. 17 experts, 15 articles, outils pratiques pour soignants et familles. Transformez vos pratiques de soins.
10 minutes
•
Débutant
•
Publications
95% trouvent cet article utile
Publié le 29 mars 2025
Mis à jour le 23 novembre 2025
Notre mythologie sur l'empathie dans les soins, 2021-2022 #
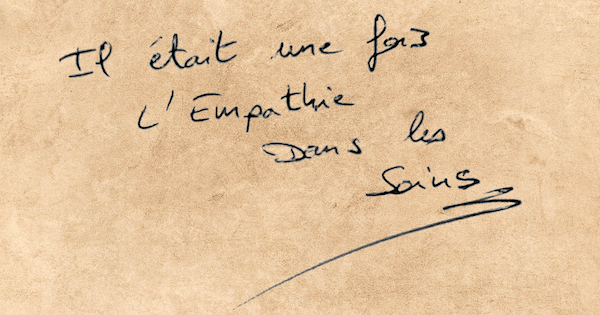
Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour
L'empathie dans les soins : la naissance d'une mythologie - Dr Éric Maeker
📅
Publié le 9 mars 2021
Mis à jour le 2 décembre 2025
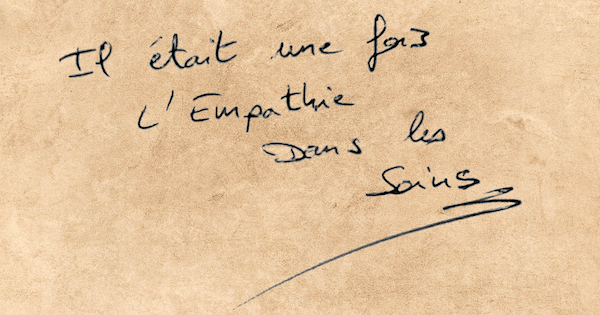
Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour
Mythe #01 : En médecine, pas d'émotion - L'empathie dans les soins
📅
Publié le 9 mars 2021
Mis à jour le 2 décembre 2025
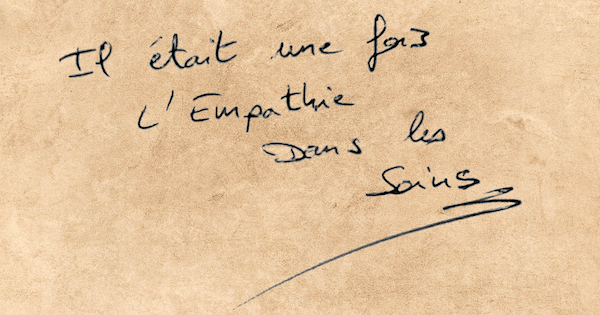
Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour
Mythe #02 : Personne ne sait vraiment ce qu'est l'empathie - Décryptage
📅
Publié le 9 mai 2021
Mis à jour le 2 décembre 2025
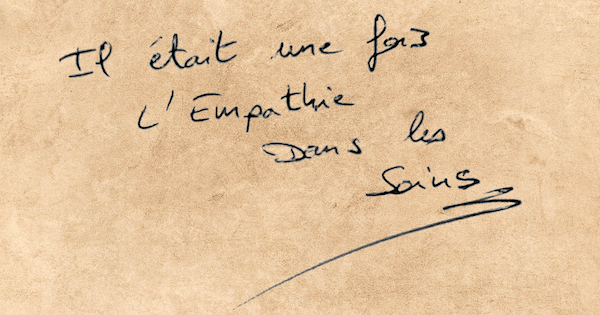
Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour
Mythe #03 : L'empathie ne s'apprend pas - Peut-on vraiment cultiver l'empathie ?
📅
Publié le 1 juin 2021
Mis à jour le 2 décembre 2025
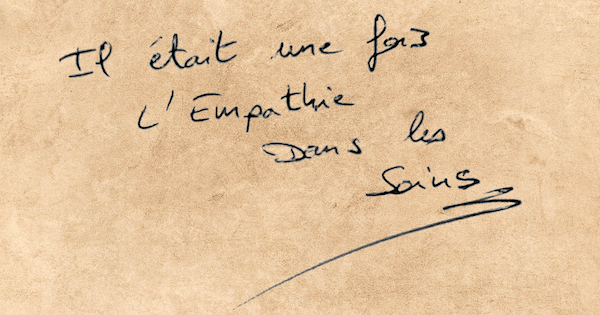
Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour
Mythe #04 : L'empathie, c'est toujours doux et apaisant - La toilette émotionnelle
📅
Publié le
Mis à jour le 2 décembre 2025
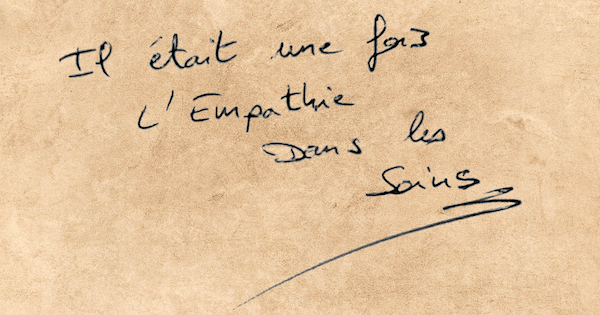
Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour
Mythe #05 : Il suffit de suivre un script - Sound of Silence et la vraie empathie
📅
Publié le 1 juin 2021
Mis à jour le 2 décembre 2025
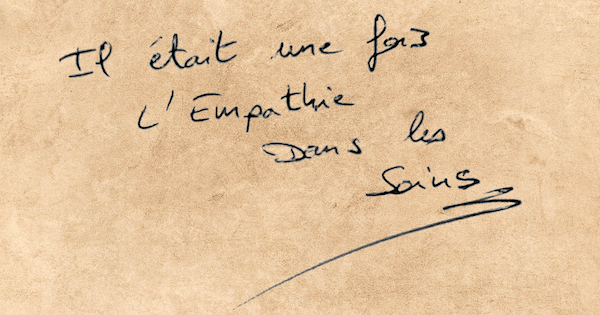
Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour
Mythe #06 : L'identification à la personne soignée est dangereuse - Empathie et identité
📅
Publié le 24 août 2021
Mis à jour le 2 décembre 2025
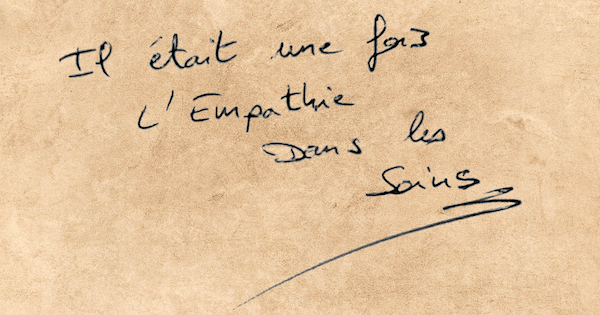
Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour
Mythe #07 : L’empathie clinique est-elle un cadeau ?
📅
Publié le 17 octobre 2021
Mis à jour le 2 décembre 2025
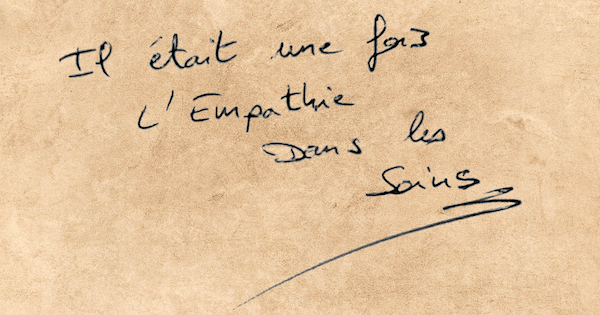
Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour
Mythe #08 : Impossible d'être empathique avec tout le monde - L'âgisme révélé
📅
Publié le 17 octobre 2021
Mis à jour le 2 décembre 2025
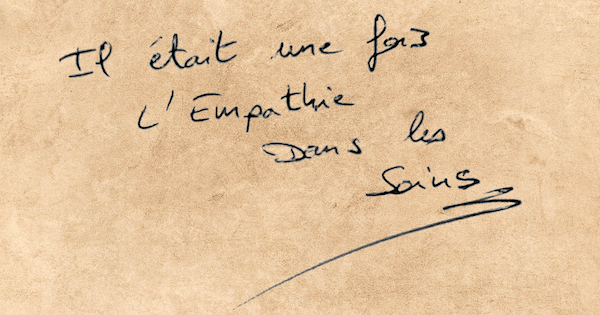
Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour
Mythe #09 : L'empathie coûte trop cher - Rentabilité et dignité humaine
📅
Publié le 27 février 2022
Mis à jour le 2 décembre 2025
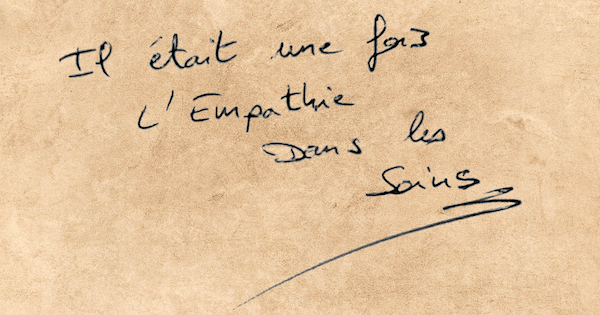
Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour
Mythe #10 : La formation médicale traditionnelle suffit-elle ? Le curriculum caché.
📅
Publié le 15 mars 2022
Mis à jour le 2 décembre 2025
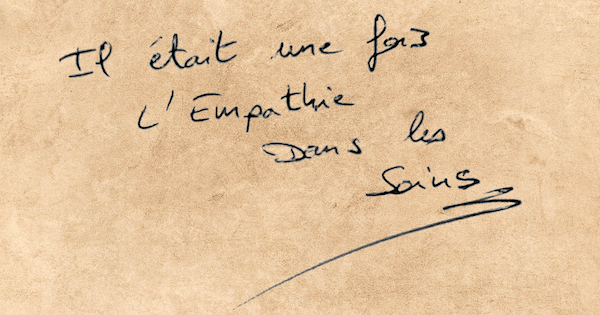
Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour
Mythe #11 : Faut-il tomber malade pour comprendre ? - Synthèse saison 1
📅
Publié le 15 mars 2022
Mis à jour le 2 décembre 2025
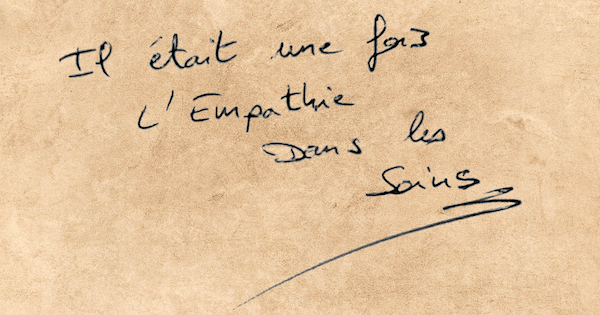
Découvrez comment l’empathie peut améliorer les soins et soutenir les aidants.Mise à jour
Saison 2 #01 : Communication empathique pratique - Définitions et fondamentaux
📅
Publié le 5 décembre 2022
Mis à jour le 2 décembre 2025

